Psy ? C'est à dire ?
Qui est qui, qui fait quoi ?
Dans un monde où le mot "psy" est partout : Psychologue, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute... À force de tout mettre dans le même sac, on finit par ne plus rien comprendre.
Certains parle d’aller "voir un psy" comme on irait chez le généraliste ou chez le coiffeur, sans vraiment savoir de quoi il s’agit ni à qui on s’adresse. Et pourtant, ces métiers, ces "psy", sont distincts, chacun avec sa formation, ses outils, sa posture, sa manière d’aborder la souffrance. Ce flou lexical ne vient pas de nulle part. Il reflète aussi un malaise contemporain face à la santé mentale, aux émotions, à la souffrance psychique. On consulte un "psy" sans trop savoir ce qu’on cherche, ni à qui on s’adresse.
Cet article a pour but de poser les bases, éclairer les rôles et dissiper les malentendus.
Il ne s’agit pas de hiérarchiser les approches, ni de distribuer bons et mauvais points, mais de mieux comprendre les différences essentielles entre ces figures du soin psychique. Parce que choisir le bon professionnel, c’est déjà faire un pas vers soi. Alors, qui est qui ? Qui fait quoi ? Et pourquoi est-ce important de le savoir ?
LES PSYCHOLOGUES
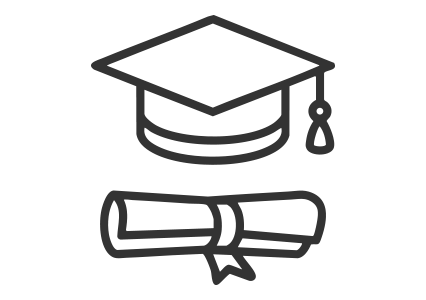 Les psychologues sont titulaires d’un diplôme universitaire de niveau Master (Master 2 en psychologie), obtenu à l’université après un parcours de cinq années d’études. Ils ne sont pas médecins, et proposent donc une lecture non médicalisée des souffrances psychiques et des difficultés rencontrées par leurs patients.
Les psychologues sont titulaires d’un diplôme universitaire de niveau Master (Master 2 en psychologie), obtenu à l’université après un parcours de cinq années d’études. Ils ne sont pas médecins, et proposent donc une lecture non médicalisée des souffrances psychiques et des difficultés rencontrées par leurs patients.
L’usage professionnel du titre de psychologue, qu’il soit ou non accompagné d’un qualificatif, est strictement encadré et réservé aux titulaires de diplômes spécifiques reconnus par l’État.
Des spécialisations leur permettent d’intervenir dans différents champs d’activité :
– psychologie clinique
– psychologie du travail
– psychologie scolaire
– psychologie sociale
– neuropsychologie
– psychologie criminelle, etc.
Les psychologues peuvent également proposer des psychothérapies, à condition d’avoir suivi une formation complémentaire spécifique.
LES PSYCHIATRES
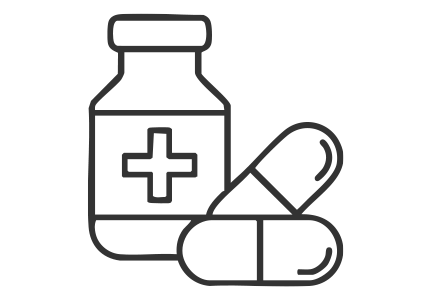 Les psychiatres sont des médecins diplômés, ayant suivi une spécialisation en psychiatrie après leurs études de médecine. Ils sont habilités à diagnostiquer des troubles mentaux, émotionnels ou comportementaux, et à prescrire des traitements médicamenteux. Certains psychiatres associent à la prescription de psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques, somnifères, etc.) des traitements psychothérapeutiques, selon leur formation et leur orientation clinique.
Les psychiatres sont des médecins diplômés, ayant suivi une spécialisation en psychiatrie après leurs études de médecine. Ils sont habilités à diagnostiquer des troubles mentaux, émotionnels ou comportementaux, et à prescrire des traitements médicamenteux. Certains psychiatres associent à la prescription de psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques, somnifères, etc.) des traitements psychothérapeutiques, selon leur formation et leur orientation clinique.
L’activité psychiatrique est strictement encadrée, et la prise en charge en psychiatrie est soumise à une autorisation spécifique à la discipline.
On distingue actuellement quatre mentions dans l’exercice de la psychiatrie :
– psychiatrie de l’adulte
– psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
– psychiatrie périnatale
– soins sans consentement
LES PSYCHOTHÉRAPEUTES
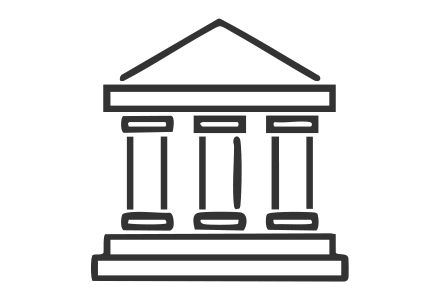 Depuis 2010, le titre de psychothérapeute est protégé par la loi en France. Cela signifie qu’il ne peut être porté que par les professionnels répondant à des critères strictement définis par les autorités sanitaires. Il est principalement accessible aux médecins (psychiatres ou non) et aux psychologues.
Depuis 2010, le titre de psychothérapeute est protégé par la loi en France. Cela signifie qu’il ne peut être porté que par les professionnels répondant à des critères strictement définis par les autorités sanitaires. Il est principalement accessible aux médecins (psychiatres ou non) et aux psychologues.
Ces professionnels doivent en plus valider une formation complémentaire en psychopathologie clinique, dispensée par une université habilitée. Une fois ce parcours validé, les psychothérapeutes peuvent exercer en libéral ou en institution, selon différentes approches thérapeutiques. Le champ de la psychothérapie est en effet pluriel : on y retrouve des courants comme la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), la psychanalyse et les approches analytiques, les thérapies humanistes, ou encore les thérapies systémiques.
LES PSYCHANALYSTES
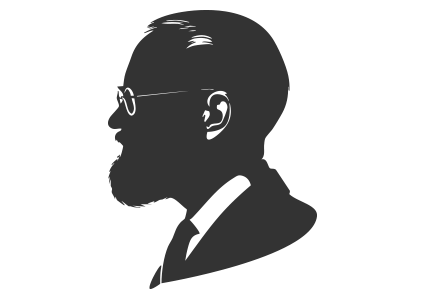 Le psychanalyste peut être psychologue, psychiatre et/ou psychothérapeute, mais ce n’est pas une obligation. Le titre de psychanalyste n’est pas protégé par la loi, et il n’existe actuellement aucune réglementation officielle encadrant son usage.
Le psychanalyste peut être psychologue, psychiatre et/ou psychothérapeute, mais ce n’est pas une obligation. Le titre de psychanalyste n’est pas protégé par la loi, et il n’existe actuellement aucune réglementation officielle encadrant son usage.
Néanmoins, il est communément reconnu, au sein du champ psychanalytique, qu’un psychanalyste dont la légitimité est établie s’est lui-même engagé dans une analyse personnelle approfondie, généralement longue et exigeante. Ce travail d’élucidation de son propre inconscient constitue le fondement éthique et clinique de la posture analytique. En effet, selon les principes fondamentaux de la psychanalyse, nul ne saurait accompagner un sujet dans l’exploration de son psychisme sans avoir lui-même traversé l’épreuve de l’inconscient, c’est-à-dire sans s’être confronté, dans la durée, à ses propres mécanismes de défense, conflits internes et zones d’ombre.
Le psychanalyste peut être affilié à une école ou une association psychanalytique, souvent rattachée à une orientation théorique ou à une figure fondatrice. Cependant, il est important de préciser que l’affiliation institutionnelle, aussi prestigieuse soit-elle, ne garantit pas à elle seule la qualité du travail thérapeutique proposé. La psychanalyse n’est pas une méthode figée ; elle repose sur un engagement subjectif profond, une éthique de la parole, et une capacité à accompagner l’autre dans les détours de son inconscient. Il s’agit d’un métier de transfert, de silence et d’écoute – qui ne s’improvise pas, même s’il n’est pas juridiquement encadré.